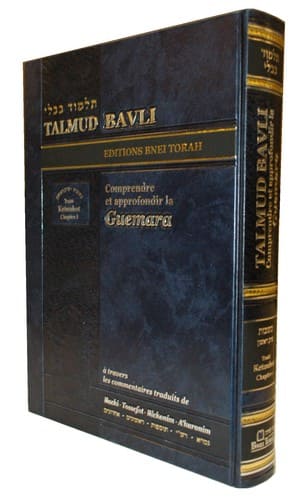Le Canon Biblique
On appelle « canon biblique » (du grec kanon, et peut-être aussi de l’hébreu, comme kana ha-mida – « canne à mesurer » [Ezéchiel 40, 5]) ceux des livres qui ont été considérés par les rabbins comme inspirés authentiquement par l’esprit divin…
S’il est vrai, en ce qui concerne la Tora proprement dite, que celle-ci ne contient nulle part d’indication explicite l’attribuant à Moïse, le lien qui la rattache à celui-ci est affirmé comme l’un des fondements de la foi juive (voir, par exemple, le huitième article de foi de Maïmonide).
Une étape importante dans la canonisation de la Tora a été franchie en l’an 457 avant l’ère commune, lorsque fut découvert, sous le règne de Josias, un rouleau de Tora qui se trouvait caché dans le Temple (II Rois – chapitres 22 et 23).
Les cérémonies qui suivirent cette découverte peuvent être considérées comme sa consécration définitive, non plus en tant qu’œuvre purement littéraire, mais en tant que livre sacré.
Quant aux livres des Prophètes et aux Hagiographes, leur canonisation a posé davantage de problèmes. Le judaïsme considère en effet que « les prophètes, après la Tora, ne peuvent apporter aucune innovation à celle-ci » (Chabbath 104a), ce qui signifie qu’elle est la seule source écrite de la halakha.
Il est également enseigné que « les prophètes n’ont ajouté ni retiré quoi que ce fût à ce qui est écrit dans la Tora, à l’exception du commandement de la lecture de la Meguila », et encore leur a-t-il fallu l’appuyer sur un verset du Pentateuque (Meguila 14a).

Il convient cependant de nuancer quelque peu cette règle. En premier lieu, la mise à l’écart des Neviim et des Kethouvim ne porte que sur la partie halakhique de la Tora, c’est-à-dire sur ce qui est du ressort de ses règles normatives.
S’agissant en revanche des préceptes moraux, il est abondamment recouru à ces textes postérieurs.
D’autre part, si les Neviim et les Kethouvim (appelés génériquement qabbala [voir Rachi sous Baba Qama 2b]) ne sont pas des sources de droit en tant que créateurs d’obligations ou d’interdictions (‘Haguiga 10b, Baba Qama 2b, Nidda 23a), ils peuvent leur servir de références ou, pour employer la terminologie talmudique, de asmakhthoth be‘alma (« rappels mnémotechniques »).
Sans entrer ici dans des détails qui n’intéressent que les chercheurs, disons, à titre d’exemples, que le livre d’Ezéchiel, l’Ecclésiaste et le Cantique des cantiques n’ont été enregistrés dans le canon biblique qu’après de longs débats entre les Maîtres du Talmud.
Quoi qu’il en soit, la tradition juive considère que le Tanakh est constitué de vingt-quatre livres (cinq pour la Tora, huit pour les Prophètes, et onze pour les Hagiographes).
On ne peut parler du canon biblique sans évoquer les ouvrages que l’on appelle « apocryphes ».
Il s’agit de livres que les rabbins n’ont pas inscrits dans ce canon, mais qu’ils ont reconnus comme fidèles à la tradition juive.
Ils sont très nombreux, et souvent très proches des Midrachim, de sorte que la frontière qui les en sépare est floue.
Nous citerons parmi les plus connus :
– Maccabées I, II, III et IV.
– Meguilath Antiokhos.
– Additions au livre d’Esther.
– Judith.
– Tobit.
– Livre des « Jubilés ».
– Baroukh.

Les anomalies scripturales
Le texte du Tanakh compte de nombreuses anomalies scripturales (5 000 selon certaines évaluations), c’est-à-dire des mots dont l’écriture ne correspond pas à leur prononciation. Ces anomalies sont de plusieurs sortes :
– Qeri kethiv : le mot ne se prononce pas de la façon dont il est écrit. Il s’agit là, le plus souvent, de libertés que le texte semble avoir prises avec la grammaire ou avec l’orthographe.
– Qeri welo kethiv : le mot est prononcé, alors qu’il n’est pas écrit.
– Kethiv welo qeri : le mot est écrit, mais il n’est pas prononcé.
– Il est d’autre sortes d’anomalies scripturales, qui consistent en ce qu’un mot ou une lettre sont surmontés de points diacritiques (dix passages dans le Tanakh selon les Avoth de-rabbi Nathan), ou en ce qu’une lettre dans un mot est d’une taille supérieure ou inférieure à celle de ses voisines.
Il serait ici fastidieux de multiplier des exemples de ces anomalies. Rappelons cependant la plus connue : celle qui consiste à prononcer le Nom divin d’une façon qui ne ressemble en rien à la façon dont il est écrit.
Ces anomalies s’imposent aux sofrim (« scribes ») qui calligraphient le texte sacré, et leur non-respect par ceux-ci entraîne l’invalidation de leur ouvrage.
Ressemblent à des « anomalies scripturales » certains changements introduits dans le texte biblique par les premiers scribes, membres de la Grande Assemblée (Kenesseth ha-guedola).
Ces changements, appelés tiqounei sofrim, modifient, par respect des convenances, certains termes employés dans le texte.
Le Midrach compte dix-huit de ces tiqounei sofrim.
L’un des plus connus est contenu dans le verset : « Tu te fianceras avec une femme, et un autre homme la possédera… » (Devarim 28, 30).
Le mot « possédera » est écrit yichgalènna (« la traitera en prostituée »), mais il est prononcé yichkavènna (« couchera avec elle »), et ce, comme expliqué par Rachi (ad loc.), par souci de décence.
Dans quatre cas, certaines lettres sont suspendues au-dessus de la ligne.
C’est le cas d’un verset du livres des « Juges » (18, 30), d’un verset des Psaumes (80, 14) et de deux versets de Job (38, 13 et 15). La raison du premier de ces cas est connue : le respect que l’auteur du texte a voulu témoigner à Moïse. Celles des trois autres est obscure.
Comme autre anomalie, citons la lettre waw dans le mot chalom (Bamidbar 25, 12), dont nous apprenons dans la Guemara (Qiddouchin 66b) qu’elle doit être coupée en son milieu.
Dans certains sifrei Tora, nous apprend Rachi (ad Berèchith 11, 32), la lettre noun du mot ‘Haran était inversée. Cette tradition est, semble-t-il, tombée en désuétude.
Continue en revanche d’être respectée celle qui veut que les lettres noun situées avant Bamidbar 10, 35 et après Bamidbar 10, 36 soient inversées. « Ces signes, précise Rachi, indiquent que le paragraphe qu’elles entourent n’est pas à sa place.
Et pourquoi a-t-il été écrit ici ? Pour marquer une pause entre deux crises, etc., comme indiqué dans toutes les écritures (voir Chabbath 116a) ».

La cantillation
Rabbi Yo‘hanan a enseigné : « Quiconque lit sans mélodie, et étudie sans fredonner un air, c’est lui que désigne le verset (Ezéchiel 20, 25) : “ Et Moi aussi, Je leur ai donné des lois qui n’étaient pas bonnes… ” (Meguila 32a).
De là découle l’importance que notre tradition a toujours attachée aux systèmes de cantillation du Tanakh, c’est-à-dire surtout à la manière dont l’officiant chante les versets de la paracha ou de la haftara.
Toute personne qui fréquente habituellement les synagogues connaît les façons différentes de lire dans la Tora selon qu’elles sont de rite achkenaze ou séfarade.
Il existe de plus, à l’intérieur de ces deux rites, et sans parler des autres (yéménite, de Cochin, etc.), de nombreuses nuances selon les pays d’origine.
Les Juifs marocains n’utilisent pas les mêmes airs que les Tunisiens, et les Polonais ne font pas comme les Alsaciens.
Ce nuances sont cependant de peu d’importance, sauf peut-être pour les fanatiques de la ‘hazanouth, si on les compare à celles qui séparent les deux systèmes d’accentuation dans le Tanakh :
Les signes d’accentuation sont divisés en deux catégories : les accents dits « des vingt-et-un livres » (ta‘amei akh), et ceux qui accompagnent les livres des Psaumes, des Proverbes et de Job (ta‘amei emeth).
La différence entre ces deux catégories est devenue théorique. On n’a pas pour habitude, en effet, de chanter les Psaumes, les Proverbes et Job en respectant ces signes.
Ce qu’il faut en retenir, c’est que les lectures publiques, qu’elles soient celle de la paracha, celle de la haftara ou celle des cinq meguiloth, prennent appui sur le même système de cantillation, même si les airs musicaux en sont différents.
Signalons que si le ‘hazan est tenu de respecter scrupuleusement la façon dont les mots doivent être prononcés, il n’est pas d’usage d’exiger la même rigueur en ce qui concerne les signes d’accentuation.
Ce qu’il doit éviter, c’est de dénaturer le texte par une cantillation erronée, ce qui peut parfois arriver lorsqu’il inverse un signe dit « conjonctif » et un signe dit « disjonctif ».
à suivre…
Jacques KOHN.