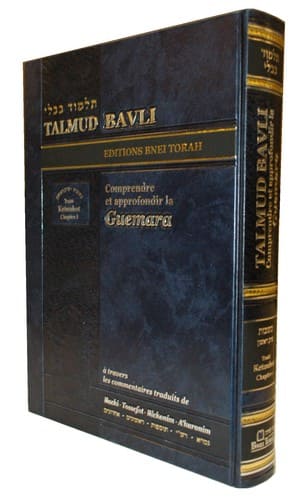Le Tour enseigne : « Il est de coutume de ne pas se marier entre Pessa’h et Atsérèt [Chavouot]. La raison en est qu’on ne multiplie pas les manifestations de joie, car c’est pendant cette période que décédèrent les élèves de rabbi Akiva » (Ora’h ‘Haïm, 493). Une décision halakhique tirant son origine d’un passage du Traité talmudique Yévamot (p.62/b) où il est enseigné que rabbi Akiva avait 24 000 élèves qui, tous, moururent pendant une seule et même période (béPérèk é’had), parce que, explique la Guémara : « ils ne s’étaient pas comportés avec « respect » les uns envers les autres – lo nahagou kevod zé lazé ».
En dehors donc de la mitsva à proprement parler de compter les jours du Omer séparant le rendez-vous (moèd) de Pessa’h de celui de Chavouot, la période du Omer doit donc être vécue, si ce n’est dans le deuil, du moins avec une certaine réserve… On ne se taille la barbe ni les cheveux, on évite d’écouter de la musique ou de prendre part à toute autre manifestation de joie et, comme cela est encore rapporté dans le Tour (Idem.), il est même d’usage de ne pas travailler pendant le laps de temps qui sépare le coucher du soleil de la récitation, en minyan, de la séfirat haOmer. Car, c’est précisément pendant ce laps de temps, à la tombée de la nuit plus précisément, qu’ont été enterrés les élèves de rabbi Akiva…
Kavod
Il convient pourtant d’interpréter cette expression à sa juste valeur. Ne serait-il pas curieux, et même franchement déplacé, de dire des élèves de rabbi Akiva qui comptaient parmi les plus grands sages de tous les temps, qu’ils se comportaient avec désinvolture et irrévérence les uns envers les autres, ou pire avec mépris ? D’autant que le terme hébraïque kavod fait certes appel au sens du respect, aux marques de déférences et d’attention dans le rapport à l’autre, etc., mais il recouvre aussi une signification plus profonde, puisqu’il désigne aussi l’idée de la « gloire » et de la majesté…
Qu’est-ce à dire ?
Comme nous l’avons rappelé ces dernières semaines au nom du rav Pinkous zatsal, la période du Omer est liée une avoda très particulière, celle de parfaire notre existence matérielle afin de pouvoir recevoir la Torah. Une idée que l’on retrouve dans la nature même du sacrifice du Omer que l’on approchait sur l’autel du Temple le lendemain de Pessa’h afin de permettre la consommation de la nouvelle récolte (‘hadach). Effectué à base d’orge (séor), un aliment destiné à la consommation animale (okhel béhéma), le sacrifice du Omer montre en quoi il est nécessaire de s’élever au-dessus des nécessités premières de notre existence afin d’acquérir les qualités requises pour recevoir la Torah.
Ainsi, commentant un passage d’une Michna du Traité Sota (p.49/b) enseignant que « depuis le décès de rabbi Akiva, le respect (kavod) de la Torah est nul et non avenu », Rachi écrit : « Parce qu’il interprétait chacune des pointes (kots) de chacune des lettres, et à plus forte raison chaque lettre ou chaque mot en surplus [dans le texte de la Torah écrite] (…). Or, voilà bien le plus grand respect de la Torah qui soit, lorsque plus une seule chose au monde manque de signification (léVatala) ». Le respect (kavod) incarné par le Tana rabbi Akiva ne saurait donc être circonscrit, pour le maître de Troyes, au seul sentiment de déférence, aux marques de courtoisie que les sages sont censés se porter les uns les autres, ni même à l’humilité. Non, le respect de la Torah incarné par le maître de Yavné fut d’avoir dévoilé la Torah – la parole divine – habitant toute chose, c’est-à-dire la gloire propre au réel, sa majesté. Car, si rabbi Akiva est à juste titre considéré comme le maître de la Torah orale, c’est précisément parce qu’il était parvenu à dévoiler la Torah (la royauté divine présente dans le monde) à partir du lieu où s’enracinait sa propre parole d’homme, à partir de sa propre existence. A la différence de Moché rabbénou réceptionnant le don de la Torah de D.ieu au Mont Sinaï, c’est-à-dire dans un mouvement partant du haut vers le bas, rabbi Akiva incarne le dévoilement de la parole divine à partir de la Terre, par le mérite d’une œuvre (avoda) qui trouve son origine en l’homme.
Torah
Et c’est de cela qu’il est question lorsque nous disons que les 24 000 élèves de rabbi Akiva ne se sont pas comportés avec « respect » les uns envers les autres « lo nahagou kevod zé lazé ». De la même manière que les enfants d’Israël durent s’élever lors des 49 jours de la séfira haOmer afin de se préparer à recevoir la Torah de Moché rabbénou au Mont Sinaï, de même les élèves de rabbi Akiva se sont trouvés devant la nécessité de s’élever à la hauteur de leur maître afin d’être susceptibles, comme lui, de révéler la Torah orale inscrite dans le creux de leur existence présente, et de parvenir, comme le dit le Rama miFano à propos de rabbi Akiva (Assara Maamarot, ‘Hakor Din, 2, 9), à éprouver cette coexistence du physique et du métaphysique au cœur même de sa propre chair. La vivre certes, mais aussi la révéler à autrui, afin que tous, à la hauteur du nombre 24 000 qu’ils incarnaient, fussent susceptibles de révéler la Torah présente au cœur de leur humanité.
Ce n’est donc pas parce qu’ils se dénigrèrent que les élèves de rabbi Akiva moururent pendant cette période, mais bien parce qu’à la différence de leur maître, ils ne parvinrent pas à révéler dans le creux de leur existence présente la charge de cette révélation : la gloire divine exaltée dans le monde et la haute existence à laquelle ce dévoilement engage. N’étant donc pas parvenus à imiter leur maître au point de lui ressembler, c’est leur vie même qui, par nécessité, s’en trouvait remise en cause…
L’alliance du Omer
Reste que cet échec, si l’on peut s’exprimer ainsi à propos du pari de rabbi Akiva de parvenir avec ses 24 000 élèves à faire surgir la Torah dans l’épaisseur du réel, nous oblige à approcher les jours de la séfirat haOmer sous la figure du deuil. Et ce, bien qu’en leur essence ces jours soient des jours de fête, celle précisément qui accompagne cette formidable possibilité qui nous a été laissée de rattacher notre dimension de créature (notre matière) à la révélation sinaïtique de son essence divine. Car, comme l’enseigne le Ramban, la période du Omer est, en droit, synonyme de joie, « les 49 jours séparant Pessa’h de la fête de Chavouot étant, à l’image des jours séparant le 1er jour de Souccot de Chemini Atsérèt, des jours de fête (‘houlo chél Moèd) » (Vayikra 23, 16). En d’autres termes : les jours du Omer comportent en eux le potentiel de nous conduire au dévoilement authentique et définitif de la Torah. Et pour cette raison, parce qu’ils sont chargés de produire la réalité spirituelle du peuple d’Israël, que les jours du Omer constituent la période où se jouent la reconnaissance historique de la Torah orale et de ses représentants, et celle du statut métaphysique d’Israël. Il n’y a donc pas à s’étonner outre mesure que ces jours soient sujets à une irrémissible tension, et voués, malgré le projet qui les sous-tend, à des règles et à des usages relevant de la rigueur (din).
C’est d’ailleurs en ce sens, nous semble-t-il, qu’il faut comprendre l’affirmation de nos maîtres, lorsqu’ils enseignent que « l’attitude qu’on y adopte sera celle vers laquelle nous serons ensuite poussée pendant tout le restant de l’année » (rav Chalom Charabi – Rachach, Nahar Chalom, p.64). Car, s’il est vrai que cette période nous conduisant au don de la Torah met en place une temporalité minimale (49 jours) dont le contenu métaphysique équivaut à celui que nous livre le déroulement d’une année entière, d’un roch haChana à l’autre (c’est en effet l’avis de rabbi Yo’hanan ben Nouri dans le Traité Edouyot, chapitre 2, Michna 10), c’est bien parce que la séfirat haOmer est, par nature, productrice de l’identité juive. Une identité que nous avons le devoir de faire coïncider avec les valeurs de la Torah, envers laquelle il nous est demandé chaque année de réitérer notre engagement et notre fidélité. Constituant le renouvellement de l’alliance, la période du Omer est donc synonyme de rigueur au point que où tout écart de conduite a nécessairement des répercussions directes sur la manière dont la parole divine – la Torah – s’enracine, non seulement en nous, mais au cœur de l’ensemble de la communauté d’Israël, c’est-à-dire sur la légitimité de notre raison d’être au monde.
La réponse du homard
Ainsi, malgré la licence et l’inconduite auxquelles sont poussés les dévots d’un dogmatisme politico-religieux bien pensant et sûr de lui qui prône l’abandon pur et simple de l’existence en exil du peuple juif (s’ils le pouvaient, ils iraient eux-mêmes placer des bombes dans les synagogues parisiennes afin d’accélérer « le retour des exilés »…), la période du Omer nous oblige à mettre un frein au déchaînement d’idéaux dont rien ne dit qu’ils ne sont pas le plus grand danger qu’ait rencontré le peuple de Judée depuis la destruction du deuxième Temple. J’entends : l’assurance que le politique, ou pire la force, doivent constituer la réponse à l’exil d’Israël.
La naissance du peuple d’Israël en Egypte fut rendue possible grâce à l’intervention miraculeuse du Saint béni Soit-Il. Pourtant, le lendemain de la plaie des premiers nés, tout est à reconstruire. Les enfants d’Israël se trouvent jetés dans l’exil, le désert, pour une période de 50 jours devant les conduire au pied du Mont Sinaï. Or c’est là, dans le désert qu’ils atteindront les plus hauts dévoilements, comme l’enseigne le Traité Chabbat (p.88/a) : lorsque le peuple s’exclama comme un seul homme « Nous ferons et nous comprendrons – Naassé véNichma » (Chémot 24, 7), 600 000 créatures célestes déposèrent sur chacune des têtes des enfants d’Israël deux couronnes : l’une pour le naassé et l’autre pour le nichma…
La nature authentique d’Israël s’est construite et se construit encore dans l’exil. Car, comme ne cesse de le répéter le Maharal de Prague tout au long de son œuvre, l’exil constitue la raison d’être de la guéoula, son moyen. Ce serait donc faire preuve, non seulement d’une totale ignorance, mais pire d’un parfait abrutissement, que de soutenir mordicus qu’Israël n’a pas besoin de la diaspora, ni d’un authentique rapport à la gola. Inversement, la Torah du désert est donc bien la condition sine qua non pour pouvoir espérer rejoindre, un jour, la terre promise, comme il est dit : « C’est Moi qui vous ai sortis du pays d’Egypte, qui vous ai conduits dans le désert quarante années durant afin que vous preniez possession du pays de l’Amoréen » (Amos 2, 10). Par Yehuda-Israël Rück