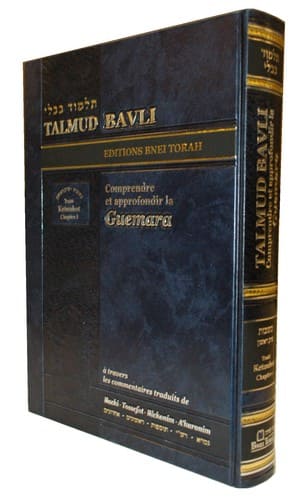Avec le Livre de Vayikra, nous entamons l’étude de la « Loi des Cohanim » – telle que nos Sages appellent ce Livre – notamment par celle des sacrifices. Essayons donc de comprendre un peu mieux ce thème malheureusement si loin de nous, mais pourtant de la plus haute importance…
Combattre l’idolâtrie
Le Rambam, dans son Guide des Égarés (III, 46), propose d’expliquer le sens des sacrifices de manière très particulière : le but de ce service serait selon lui d’ôter du coeur des hommes toute attache aux cultes idolâtres… Nous savons en effet qu’en ces temps reculés, la majorité des peuples de la terre se livraient au culte des idoles. À cet effet, les hommes édifiaient des temples pour leurs statues et leur offraient des sacrifices dans l’espoir que la puissance de leur « destinée » soit renforcée, et que la réussite et le bonheur jaillissent sur terre par leur entremise. Or parmi ces cultes, deux se distinguaient en particulier : celui des Égyptiens et celui des Chaldéens.
Les Égyptiens, nous l’avons vu lors du récit de la sortie d’Égypte, livraient un culte à l’agneau, ou plutôt à la con s t e l lat ion a s t r olog ique du Bélier. A leurs yeux, c’est à partir d’elle qu’ar r ivent sur terre les plus grandes richesses, notamment en l’espèce des moutons qui fournissent à l’homme de la viande, du lait, et la laine nécessaire à ses vêtements. Par égard pour ce pouvoir incarné par le bélier, ils s’interdisaient la consommation du petit bétail et se refusaient même d’en tirer une quelconque jouissance ; voilà pourquoi le métier de berger était si mal vu dans l’Égypte de ces temps, comme en témoigne le verset : « Car les Égyptiens ont en horreur tout pasteur de menu bétail » (Béréchit 46, 34). Les Chaldéens, peuple de Mésopotamie souvent évoqué dans le Talmud pour sa maîtrise de l’astrologie et de la divination, révéraient quant à eux le gros bétail.
Pour eux, les bêtes de trait – symbole du labour – incarnent l’équilibre économique du monde, dont la force émane de la constellation astrologique du Taureau. En l’honneur de cette « force », ces peuplades s’interdisaient formellement l’abattage et la consommation du gros bétail. Et effectivement, précise le Rambam, nous savons que jusqu’à ce jour, les peuples d’Inde vouent une adoration aux fameuses « Vaches sacrées » qui personnifient à leurs yeux les forces spirituelles d’où ils tirent leur subsistance.
Voilà pourquoi, soutient Maïmonide, la Torah souligne dès les premiers mots du Livre de Vayikra que pour offrir un sacrifice : « c’est dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande » (Vayikra 1, 2). De la sorte, nous manifestons notre réprobation à l’égard de l’idolâtrie : « Ce qu’eux considèrent comme le sommet du culte, nous l’utilisons comme l’objet éminent de notre expiation ! ». C’est donc pour écarter au maximum toute tendance idolâtre que nous pratiquons le service du Temple, afin de consac r e r les divinités païennes au Créateur Unique et Tout-Puissant. De la sorte, conclut enfin le Rambam, s’explique pourquoi les sacrifices sont systématiquement qualifiés de « réa’h ni’hoa’h » – des « odeurs agréables » devant D.ieu – parce que lorsque l’humanité entière sera unifiée au service du D.ieu unique et aura éradiqué toute forme d’idolâtrie, pourra alors éclater la Gloire de Son Nom.
Trois niveaux de fautes
Cette explication ne fit évidemment pas l’unanimité. Le Ramban (dans son commentaire sur le verset 9), proteste vigoureusement contre cette approche. Le problème essentiel dans la thèse du Rambam réside selon lui justement dans cette expression de « réa’h ni’hoa’h » : « Comment peut-il considérer la Table de D.ieu comme un instrument simplement destiné à détromper ces mécréants et ces sots, alors que le verset appelle les sacrifices des “offrandes approchées comme une odeur agréable“ ? ». En outre, s’étonne le Ramban, n’est-il pas au contraire tout à l’honneur de ces peuplades que l’on utilise l’objet de leur culte comme sacrifices dans le Temple du D.ieu unique ? S’il nous importait vraiment de combattre leurs croyances futiles, il aurait été certainement plus adéquat de manger de leur chair à notre faim, puisque c’est justement là l’attitude que ces hommes interdisent en vertu de leurs croyances… Enfin, dernier argument mais non des moindres, on constate que de nomb r e u x h omme s ont approché des sacrifices en l’honneur de D.ieu en des temps où l’idolâtrie n’existait pas… En effet, lorsque Noa’h sort de l’arche avec ses trois fils, il n’y a sur terre pas un seul Égyptien ou Chaldéen susceptible de servir une constellation. Pourtant, Noa’h approche un sacrifice devant D.ieu, Qui l’accepte favorablement en humant la délectable odeur et en déclarant même : « Désormais, Je ne maudirai plus la terre à cause de l’homme » (Béréchit 8, 21). A l’aube de la Création, Caïn et Hévél avaient eux aussi approché des sacrifices en l’honneur de D.ieu, bien qu’aucune tendance idolâtre ne se soit encore manifestée sur terre. En conséquence, le Ramban considère que les sacrifices doivent nécessairement être propices à susciter la miséricorde divine de manière positive, et pas seulement en contestant les différentes formes de paganisme. D’après cet auteur, il convient d’établir une corrélation entre la manière dont une faute est perpétrée et les différentes pratiques du sacrifice.
Trois niveaux de l’acte
Tout acte qu’un homme réalise, explique le Ramban, prend corps par la pensée, la parole et l’action. Pour expier une faute, D.ieu nous ordonne donc d’amener une bête en sacrifice, sur laquelle le fauteur procèdera en un premier temps à la « semikha » – littéralement « l’appui » qui consiste à exercer une pression avec les deux mains entre les cornes de la bête –, afin de susciter le pardon divin sur l’acte à proprement parler. En un second temps, l’homme devra également prononcer un « vidouy » – une formule de confession – et ce, afin d’expier les paroles malveillantes prononcées. Ensuite, on brûlera sur le mizbéa’h les entrailles de la bête – symbole des projets échafaudés et des tentations – afin d’effacer le mal émanant des pensées fautives. Enfin, on brûlera également les pattes de la bête pour représenter les bras et les jambes de l’homme par lesquels la faute fut réalisée, et l’on aspergera aussi le sang de la bête sur les angles du mizbéa’h, pour faire prendre conscience à l’homme que c’est son propre sang qui aurait dû être versé à la place de celui de son sacrifice.
Du potentiel à l’actuel
Deux approches s’offrent à nous pour comprendre ces explications du Ramban. Car s’il est bien avéré que tout acte découle nécessairement d’une pensée, rien ne prouve cependant que la parole soit systématiquement impliquée lorsqu’une faute est commise. En première proposition, nous pourrions concevoir que le sacrifice vient expier les différentes possibilités de la faute : non que toute faute soit obligatoirement accompagnée d’une parole, mais plutôt que la parole constitue l’une des différentes manières de fauter. Le sacrifice offrirait donc plutôt une expiation pour l’ensemble des moyens de fauter, et agirait en fonction des circonstances par lesquelles la faute a concrètement été commise. Néanmoins, cette explication supposerait que même la pensée – indépendamment de l’acte ou de la parole – requerrait aussi une expiation pour elle seule.
Or un principe talmudique établit clairement que « D.ieu n’associe pas les mauvaises pensées à l’acte » (Kidouchin 39/b) – sous-entendu pour accabler le fauteur… Pourquoi donc expier ce qui n’est pas considéré dans le Ciel comme une faute ? Force serait alors d’en conclure que la pensée ne réclame pas d’expiation à elle seule, mais seulement en tant que vecteur d’un acte ou d’une parole. Ceci nous conduirait donc à dire une fois de plus que le sacrifice expie non les différentes manières dont une faute peut être commise, mais plutôt les composantes inhérentes à toute faute…
Voilà pourquoi il semble plus probable d’interpréter les paroles du Ramban selon une autre approche, d’après laquelle tout acte sans exception est effectivement composé à la fois d’une pensée, d’une parole et d’un acte… Lorsque le Ramban parle de « pensées », il convient de comprendre ce terme dans un sens très large, puisqu’il désignerait plus précisément la conscience profonde et la volonté intime enfouie au plus profond de l’être. Il évoque d’ailleurs lui-même cette « pensée » en parlant des reins qui, comme nous le savons, génèrent chez l’être humain le « conseil », autrement dit l’intention première qui conduit à la faute.
En un second temps, l’acte se traduit par une « parole » – non en tant qu’articulation de mots mais dans son acception la plus large, c’est-à-dire dans cette capacité à extraire une idée du domaine conceptuel pour la « dessiner » et « l’habiller » en une réalité actuelle. Ensuite seulement l’homme donne concrètement corps à l’acte ainsi élaboré par les membres de son corps. C’est donc bien par trois étapes que tout projet humain est mis en application, sans lesquelles on ne saurait parler d’ « actes » proprement dits.
Compromis…
Le Méchekh ‘Hokhma, pour sa part, propose un compromis entre les opinions du Rambam et du Ramban. Il remarque qu’au fil de l’Histoire, les sacrifices furent pratiqués par le peuple juif de deux manières totalement différentes, voire même opposées. Jusqu’à l’édification des différents Temples, il existait en effet la notion de « bama », c’est-à-dire des autels personnels que chacun pouvait construire où bon lui semblait, et y apporter des sacrifices par lui-même. La Michna (Zéva’him ch. 14) énumère les périodes où la pratique des bamot était autorisée et celles où elle fut interdite. Celles-ci correspondent aux périodes où un Sanctuaire était établi de manière fixe, tel le Temple de Jérusalem. Or, note le Méchekh ‘Hokhma, les Sages nous enseignent qu’entre autres différences, la « bama privée » se distingue de celle de la communauté par l’absence de « réa’h ni’hoa’h » (ibid. michna 10).
Aux yeux de ce maître, cette nuance vient précisément articuler la différence d’opinion entre le Rambam et le Ramban : si la bama est dépourvue d’ « odeurs agréables », c’est justement parce que son but n’était que d’éloigner les hommes des cultes idolâtres…
En revanche, lorsque le Tabernacle ou le Temple de Jérusalem furent construits, les sacrifices prirent une connotation nettement plus importante : désormais, leur but était effectivement de « réparer » les torts commis par les hommes, en expiant la faute à tous ses niveaux. Le Méchekh ‘Hokhma ajoute que cette explication apporte un remarquable éclairage sur un autre point lié à ce thème. Dans le traité Méguila (p. 10/a), les Tossefot rapportent l’avis étonnant de Rabbi ‘Hayim Cohen selon qui l’interdiction des bamot aurait été maintenue jusqu’à ce jour, même selon l’avis affirmant que la sainteté de Jérusalem n’a pas survécu à la destruction du Temple (kidcha léchaata, vélo kidcha léatid lavo).
Généralement, on considère ces deux thèmes comme étant intimement liés : si la sainteté du Temple est toujours en vigueur, il y a effectivement lieu d’interdire les bamot, compte tenu de la possibilité – tout au moins théorique – d’approcher des sacrifices à Jérusalem. Et donc inversement, si la sainteté s’est échappée, rien ne serait susceptible d’interdire les bamot. Or voilà que d’après ce maître, l’un n’empêche pas l’autre : même si Jérusalem n’est plus sanctifiée, les bamot n’en restent pas moins interdites ! À la lumière des explications du Méchekh ‘Hokhma, cette position s’éclaircit de manière évidente : nous savons que dès la première période du Second Temple, les Hommes de la Grande Assemblée (Anché Knesset haGuedola) ont éradiqué la tentation de l’idolâtrie de la surface du globe. Dans leur immense sagesse, ces Sages comprirent que les générations suivantes, à l’égard de leur bas niveau spirituel, seraient désormais incapables de résister au terrible attrait de l’idolâtrie. Ils décidèrent donc d’invoquer la Miséricorde divine pour que cette appétence cesse de tarauder les hommes. Par conséquent, affirme le Méchekh ‘Hokhma, le combat que l’on menait jadis contre le culte des idoles n’avait plus lieu d’être après cette période, étant donné que ce yétser hara n’existait désormais plus. Voilà pourquoi, après le Second Temple, les bamot furent prohibées à jamais dans la mesure où leur rôle, qui consiste à éradiquer l’idolâtrie comme l’affirme le Rambam, n’était plus justifié. L’interdiction des bamot fut donc maintenue en toute circonstance, indépendamment de la sainteté ou l’absence de sainteté régnant de nos jours à Jérusalem.
YONATHAN BENDENNOUNE
[ en partenariat avec Hamodia ]